 C’est du Prix Femina étranger (décerné le 5 novembre) que je veux aujourd’hui vous entretenir.
C’est du Prix Femina étranger (décerné le 5 novembre) que je veux aujourd’hui vous entretenir.
Prêtant sa plume à un collectif imaginaire de femmes, la romancière américaine d’origine nippone, évoque l’immigration, au début du vingtième siècle, de Japonaises promises à des compatriotes installés en Californie.
» Sur le bateau nous avions emporté dans nos malles tout ce dont nous aurions besoin dans notre nouvelle vie: un kimono de soie blanche pour notre nuit de noces, d’autres en coton coloré pour tous les jours, de plus discrets pour quand nous serions vieilles, et puis des pinceaux à calligraphie, d’épais bâtons d’encre noire, de fines feuilles de papier de riz afin d’écrire de longues lettres à notre famille, (…)la poupée avec laquelle nous dormions depuis que nous avions cinq ans, (…) le miroir d’argent donné par notre mère, dont les dernières paroles résonnaient encore à notre oreille. Tu verras: les femmes sont faibles, mais les mères sont fortes. »
La candeur, la naïveté des attentes et des questions qui tarabustent les jeunes femmes cèdera la place à la réalité parfois brutale et dure de leur nouvelle vie et des compagnons imposés.
« Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous, il n’y a pas à s’inquiéter. Et nous aurions tort. »
Réduites à un labeur de champs, de bonnes et même de prostitution, la plupart de ces femmes se résigneront avec une abnégation ethnique à cet esclavage implicite. La guerre viendra qui mettra la communauté au ban de la société et parquera les hommes dans la « sécurité » de camps d’internement.
C’est sur cette note de silence que s’achève ce singulier – et poignant – récit d’un destin pluriel.
AE
Certaines n’avaient jamais vu la mer, Julie Otsuka, trad. de l’américain par Carine Chichereau, Ed. Phébus, 144 pp, 15 €





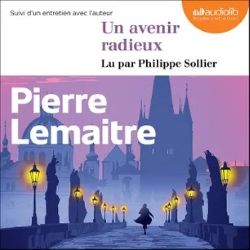
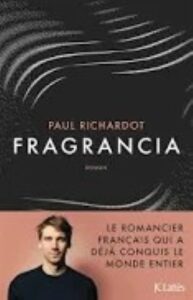





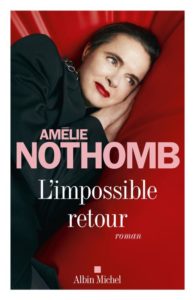



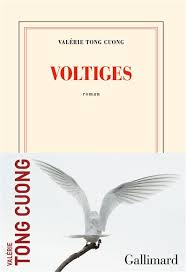
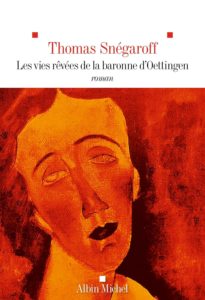

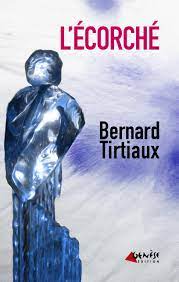

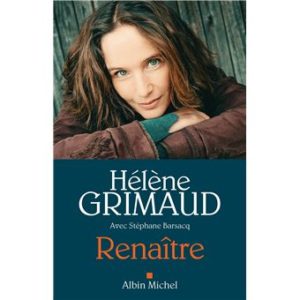


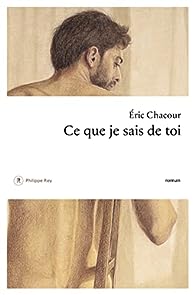

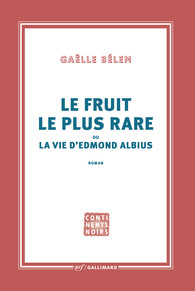
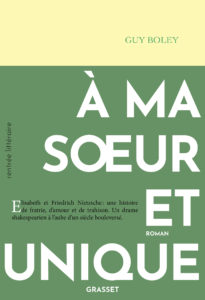
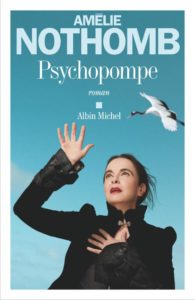




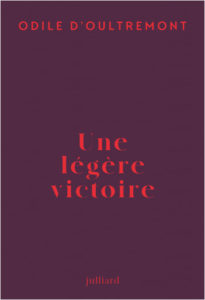
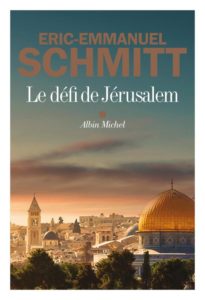

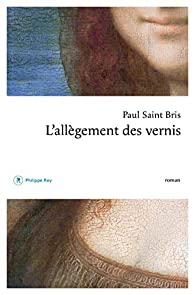

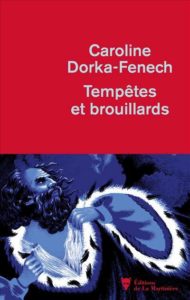


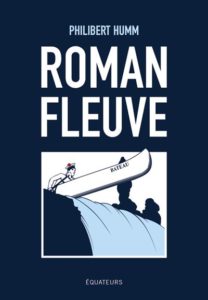



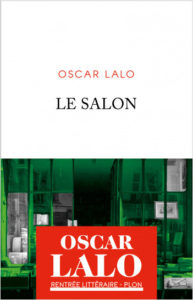
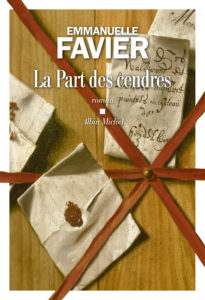
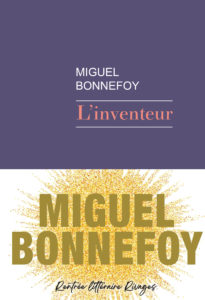


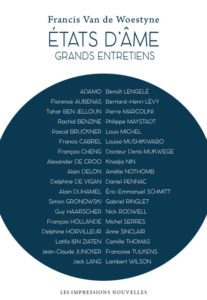
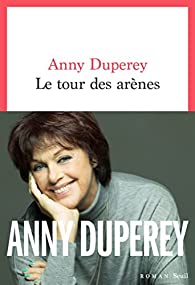
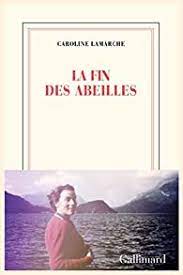
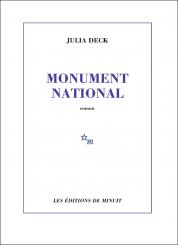
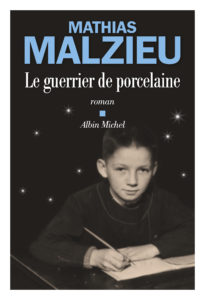








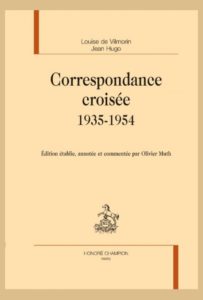




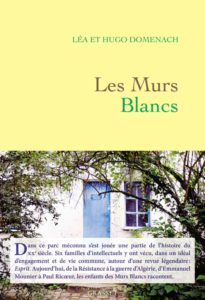


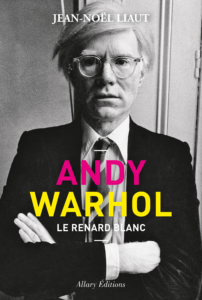

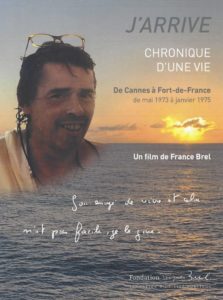

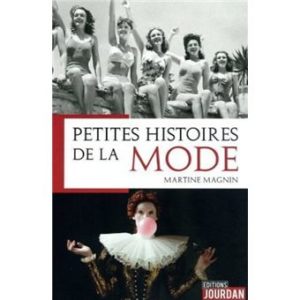





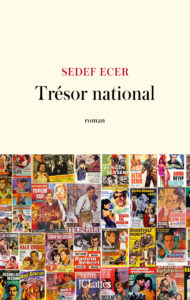






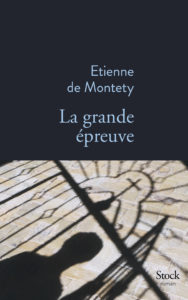










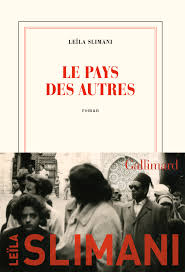














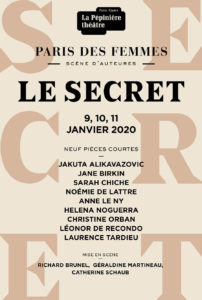
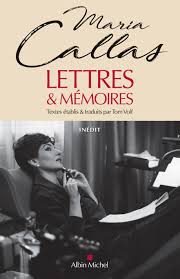
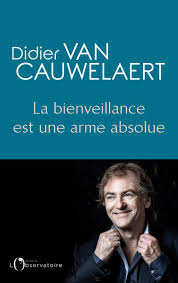
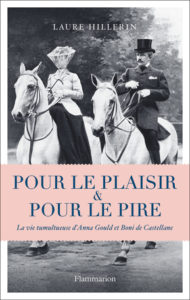




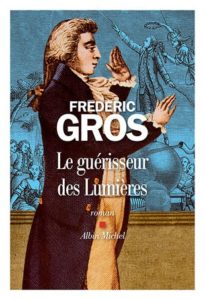
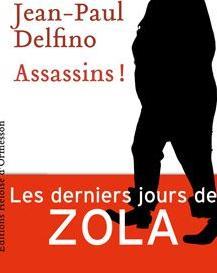
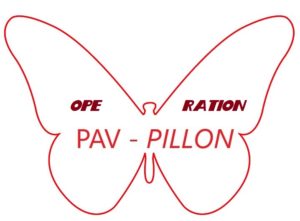


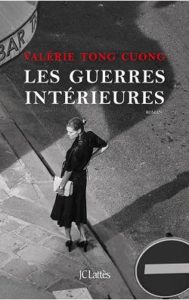











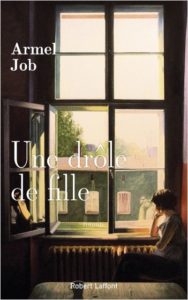
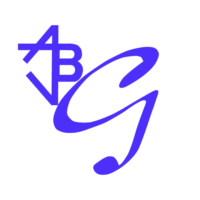


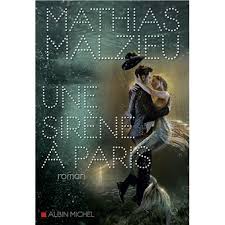
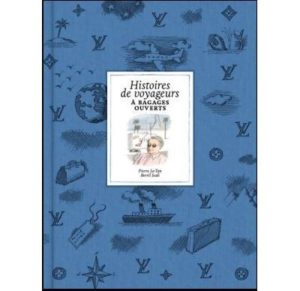



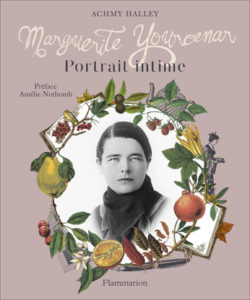
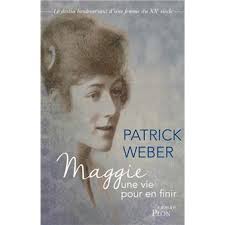

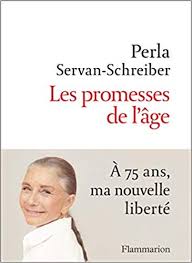




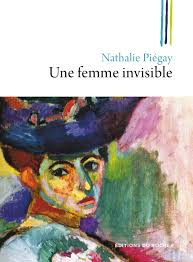



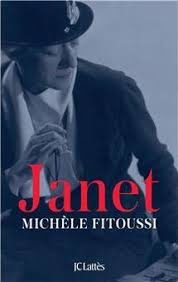

Commentaires récents